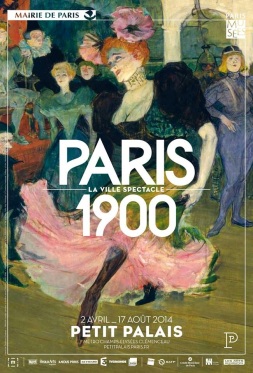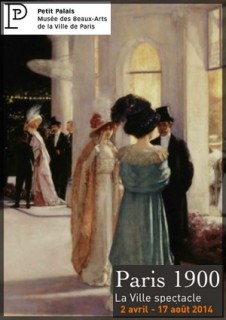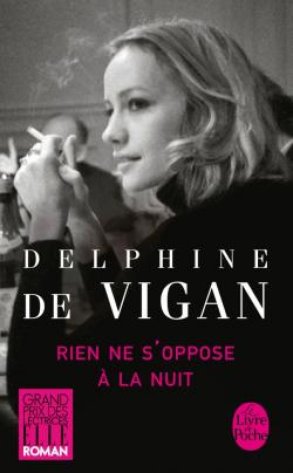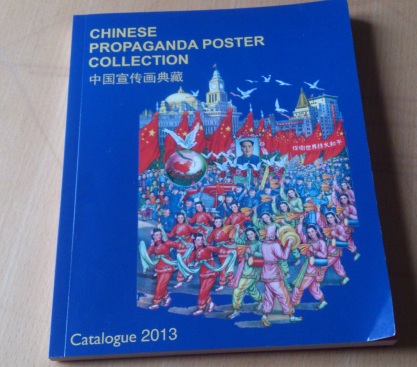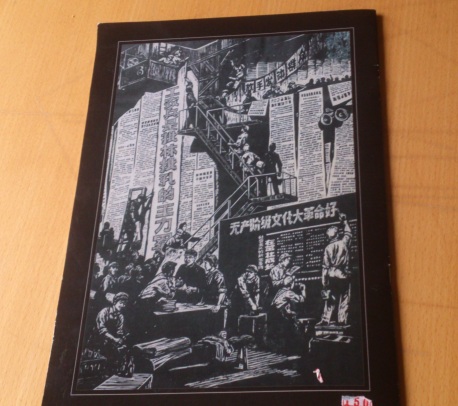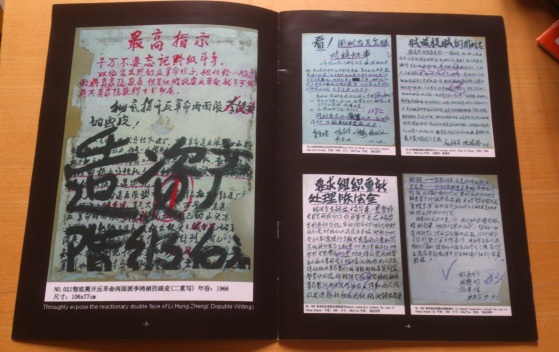Restons sur la science-fiction et parlons d’intelligence.
« Conte rendu N° 1
3 mars. Le Dr. Strauss dit que je devrez écrire tout ce que je panse et que je me rapèle et tout ce qui m’arrive à partir de maintenan. Je sait pas pourquoi mais il dit que ces un portan pour qu’ils voie si ils peuve mutilisé. J’espaire qu’ils mutiliserons pas que Miss Kinnian dit qu’ils peuve me rendre un télijan. »
Ce texte à l’orthographe déroutante est en fait de l’ouverture du roman Des fleurs pour Algernon, de Daniel Keys. Dans ce livre, un homme nommé Charlie Gordon relate dans son journal l’expérience qu’il subit. Il a trente-deux ans. Il travaille dans une boulangerie pour 11 dollar par semaine. Et surtout, il est attardé mental. Charlie n’est pas en mesure de comprendre les conventions sociales. Il fonctionne comme un enfant coincé dans les premiers stades de son développement. Abandonné par sa famille, Charlie devient le cobaye de plusieurs chercheurs qui souhaitent développer son intelligence grâce à une série de stimulis pratiqués sur le cerveau. L’opération a déjà été testée sur une souris nommée Algernon. Ce premier essai a été couronné de succès : l’intelligence d’Algernon est devenue largement supérieure à celle d’une souris normale. Reste à tenter l’expérience sur un être humain. C’est Charlie, donc, qui est choisi. Charlie est consentant. Enfin, dans les limites de ses capacités. Même s’il est attardé, il perçoit que quelque chose en lui le rend différent des autres. Il s’accroche ainsi à l’espoir de cette expérience scientifique, devenir enfin « un telijan », comme les autres, pour avoir enfin des amis qui l’aiment…
Pas de suspens. L’opération fonctionne. De jour en jour, par petits paliers, Charlie voit ses capacités mentales se décupler jusqu’à dépasser largement celles d’un être humain. Tout le roman est conté du point de vue de notre cobaye scientifique, au travers des comptes-rendus qu’il écrit pour l’équipe scientifique, dans le cadre de l’expérience. Le lecteur découvre ainsi, en même temps que Charlie, le déploiement de cette intelligence qui ne semble plus avoir de limite. Se pose à ce stade une question : que va faire notre héros de cette intelligence extra-ordinaire ? Sans surprise, il va d’abord lire et apprendre, étancher une curiosité insatiable, puis poursuivre lui-même la suite des recherches scientifiques sur l’opération que lui et la souris Algernon ont subi. Et, il ne sera pas au bout de ses surprises. Au fil des découvertes, il va réaliser ce qu’il y a, une fois que les limites du développement intellectuel sont atteintes.
N’en déplaise aux adeptes du transhumanisme qui peinent un peu à différencier une intelligence artificielle d’un être humain, la beauté et la sagesse de livre consistent à ne pas réduire cette intelligence à une question de performance. Parallèlement à ses recherches scientifiques, Charlie Gordon va également poursuivre deux espoirs. Premier espoir, comprendre qui il est. Pourquoi sa famille l’a-t-elle abandonné ? Où sont ses parents ? Qui ont-ils été ? Plus, il devient intelligent et plus la mémoire lui revient et les souvenirs l’assaillent. Et deuxième espoir, être aimé. Charlie, l’attardé mental livré à lui-même n’avait pas d’amis et ne désirait rien d’autre que de devenir comme les autres pour être accepté d’eux. Charlie, le cobaye, est conscient de cette intelligence hors-norme qui le sépare du reste de l’humanité. Il en mesure le prix à payer, la solitude. Lequel de ces deux Charlie souffre le plus ? Celui-qui en trop ou celui qui n’en a pas assez ?
L’expérience a été mise au point par des scientifiques, qui malgré leur savoir, restent des êtres humains assez ordinaires. Ces hommes n’ont pas vu qu’elle comportait une faille aux conséquences très graves, très tragiques. Charlie, lui, finit par la détecter, réaliser ce qui l’attend, malheureusement, et comprendre comment s’en servir pour réaliser son second désir, être aimé. Ou plutôt, accéder à l’amour, dans les possibilités qui lui sont données.

Rodin, le Monument à Victor Hugo et Le Penseur, Edward Steichen, 1902. Tirage à la gomme bichromatée
Tout au bout, je vois de nouveau la lumière, une ouverture dans la plus obscure des cavernes, pour le moment minuscule, et lointaine – comme si je la regardais par le bout d’une longue-vue – puis brillante, aveuglante, chatoyante et de nouveau, une fleur aux multiples pétales, un lotus tournoyant qui flotte près du seuil de l’inconscient. A l’entrée de la caverne, j’y trouverai la réponse si j’ose y retourner et plonger dans la grotte de lumière qui est au-delà.
Pas encore !
J’ai peur. Pas de la vie, ou de la mort, ou du néant mais de tout perdre comme si je n’avais jamais été.